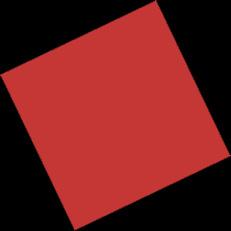De l'affaire de mobbing à l'affaire Rigot
Quelques considérations pour ne pas recommencer
En dix ans – 1996-2005 – et 4 périodes, une affaire de mobbing à la commune de Vevey est devenue «l’affaire Rigot». Cette dernière étape tend à occulter les autres. Elles sont pourtant toutes utiles pour la réflexion, à l’ordre du jour, sur le bilan de la Municipalité en place et sur ce qui serait souhaitable pour la prochaine. Ce texte, reprenant les débats du Conseil communal, les jugements des tribunaux et le rapport Reymond, tente d’y contribuer. Le traitement par la presse de l’affaire, notamment par Le Régional, est laissé de côté malgré son importance, pour des raisons de temps et de volume.
1. La Municipalité en place en 1996 sous-estime la gravité de l’affaire, et la traite, à ce qu’on peut en savoir aujourd’hui, de la pire façon possible.
En 1995-1996, une employée de la commune est victime de mobbing de la part de son chef (voir «Faits» dans l’arrêt du Tribunal Fédéral ou «Origine du litige» dans le rapport Reymond (pp.3-5 [1]). La Municipalité (de 1994 à 1997, P. Aguet, P. Chiffelle, Y. Christen, R. Rota, et N. Keller, responsable du dossier au dicastère de l’éducation dont dépendait cette employée) reconnaît le dommage qu’elle a subi, en adressant un blâme à son chef, mais lui propose un reclassement au cimetière avec baisse salariale (forme inédite de soutien psychologique pour une personne en crise !), puis la licencie. Vraisemblablement, un Service du personnel sous-dimensionné (1 seul poste chapeautant personnel et informatique, jusqu’à récemment encore) a contribué à la légèreté de cette procédure. Mais cela n’explique pas pourquoi cette affaire n’a jamais été mentionnée dans les rapports de gestion (pas la moindre allusion, même oralement en séance, et le licenciement de la personne mobbée n’apparaît même pas dans les statistiques du personnel). La conviction d’avoir pris la bonne décision aurait dû, au contraire, pousser à sa publication.
La responsabilité de l’exécutif communal est attestée par le Tribunal cantonal vaudois (Cour civile), qui condamne très nettement la commune le 4 avril 2003. Ce jugement est confirmé par le Tribunal fédéral, saisi par la commune d’un recours contre sa condamnation, dans son arrêt du 13 octobre 2004, qui souligne: «S'agissant du montant de l'indemnité […] la cour cantonale a également mis en lumière le fait que […] que la faute de l'auxiliaire [le chef] de la défenderesse [la commune] était particulièrement grave - celui-ci ayant harcelé pendant près d'une année la demanderesse [l’employée], qui était au service de la défenderesse depuis environ quatorze ans - et enfin que celle-ci, une fois avertie, n'avait pris aucune mesure sérieuse et efficace, mais avait au contraire licencié la demanderesse, qui s'était retrouvée sans aucun soutien, ce qui n'avait fait qu'intensifier l'atteinte à sa personnalité.» Le rapport Reymond (p. 34, question 8) ne dit pas autre chose: «[…] si la Commune a perdu le procès, c’est parce que la cause était mauvaise et que l’appréciation de l’ancienne Municipalité d’après laquelle la situation conflictuelle […] en 1995/1996 était principalement imputable à Mme X. s’est révélée fausse.»
Il est nécessaire de reconnaître cette responsabilité originelle; mais cela ne revient pas à absoudre les municipalités suivantes, ni l’avocat de la commune, on y reviendra.
2. Les Municipalités suivantes n’ont pas pris la mesure du problème, et ont maintenu le secret sur l’affaire
La politique du secret a perduré et, de 1996 à 2004, pas la moindre information n’a été donnée au conseil communal (rapport annuel de gestion de la Municipalité), ni à sa commission de gestion. De même, les municipalités qui se sont succédé n’ont pas pris la mesure de l’erreur commise en 1996, bien que les affaires de mobbing aient été considérées avec un sérieux croissant. C’est ainsi que, selon le rapport Reymond (voir «Offres transactionnelles», pp. 12-13), il n’a pas été répondu à une offre transactionnelle de M. Subilia (avocat de l'ex-employée) en juillet 1999 (Municipalité Aguet, Burnier, Chiffelle, Christen, Rota [2]), ni à ses demandes que la Municipalité fasse elle-même de telles propositions, fin 2001 (Municipalité Ballif, Burnier, Chiffelle, Christen, Rota) et début 2002 (Municipalité Ballif, Burnier, Ducraux, Dupont, Rigot).
Par qui ce dossier a-t-il été géré durant ces années ? Est-il resté sous la responsabilité du dicastère de l’éducation (N Keller, puis P. Chiffelle puis P.-A. Dupont) ? Ou a-t-il passé sous la responsabilité du Secrétariat municipal et du Syndic ? A-t-il même été géré ? On peut en effet imaginer que, convaincue d’avoir réglé l’affaire par le licenciement de 1996, la Municipalité de 1994-1997 a mis le dossier au fond d’un placard. Dès ce moment, vu la grande stabilité de l’équipe municipale jusqu’à fin 2001, nul n’aurait eu intérêt à l’en ressortir et à le réétudier. Il n’apparaît d’ailleurs pas que l’avocat D. Rigot, engagé par la commune le 29 août 1997 (soit un peu avant la fin du contrat de l’employée communale), ait fait, à un moment ou à un autre, des propositions dans ce sens, bien qu’il se présente comme spécialiste, notamment, du droit du travail (voir sa présentation professionnelle, état janvier 2006 ou le site de son étude).
De plus, une occasion de reprendre en main ce dossier n’a pas été saisie: lors de la séance du Conseil communal du 11 mars 1999, notre groupe avait déposé une interpellation très générale sur le thème du mobbing, demandant si la Municipalité était consciente du risque et si des dispositions étaient prises. La réponse fut que tout allait bien… sans aucune référence à l’expérience faite en 1995-1996, ni aux perspectives d’échéance judiciaire. Ignorance ou politique du secret, la question reste posée. Mais dans les deux cas, ce n’est pas un fonctionnement correct d’une administration publique qui devrait cultiver continuité et transparence.
Une réévaluation de la décision de 1996, et une transaction, avant le procès, était-elle possible ? Ce n'est pas exclu. Aurait-elle été plus avantageuse ? Peu importe, puisqu’il s’agissait de rendre justice à la victime. Mais il est certain que cela aurait évité à Vevey une affaire qui a pourri le climat politique.
3. La nouvelle Municipalité, qui entre en fonction en en 2002, ne change pas de ligne; pratiquant collégialement le «chacun pour soi», elle fait une confiance aveugle à son avocat-syndic, et refuse de répondre aux questions venant du législatif.
Le renouvellement quasi total de la Municipalité après les élections de 2001, aurait pu donner lieu à un réexamen de la question. Or, malgré les prétentions tonitruantes de D. Rigot à incarner une rupture avec les municipalités précédentes (voir deux textes dont il est, semble-t-il, l’auteur: la «déclaration de politique générale» du parti radical du 1er septembre 2005 et le communiqué du même parti le 5 décembre 2005), la continuité, comme dans d’autres domaines, s’est imposée. En l’occurrence, ce n’est guère étonnant puisque le nouveau syndic est alors l’avocat de la cause depuis 5 ans, et que le chef du personnel est toujours en place, de même que le secrétaire municipal. L’évaluation erronée de la gravité du cas – et donc des chances de succès devant la justice – persiste ainsi au-delà même de la condamnation de la commune en avril 2003 (Tribunal cantonal), et se manifeste par le refus de conclure un accord avant que les considérants du jugement soient connus, puis par la décision de faire recours au Tribunal fédéral (voir ci-dessous § 4).
D. Rigot, en tant qu’expert en la matière et chef de la Municipalité, en est certes le principal responsable, mais l’ensemble de la Municipalité l’a laissé faire. On touche là à un premier type de problème dans le fonctionnement de la Municipalité: chaque municipal s’est enfermé dans la gestion de son dicastère, ne se mêlant pas plus des affaires des autres qu’il ne souhaitait que les autres se mêlent des siennes. C’est ainsi que la Municipalité a totalement délégué cette affaire au syndic, et que, notamment, nul ne s’est préoccupé de la double casquette de l’avocat-syndic. Dès lors, comme le constate le rapport Reymond (p. 35, questions 3 et 4) la Municipalité dans son ensemble est coupable d’avoir violé son propre règlement. Ayant prêté serment de «contribuer au maintien de l’ordre» et «d’avoir […] la justice et la vérité devant les yeux», il aurait été du devoir des autres membres de la Municipalité de porter eux-mêmes le cas devant l’autorité de surveillance. En renonçant à le faire, par crainte de se dénoncer eux-mêmes, ils donnent une bien mauvaise image de leur fonction.
Les effets du «chacun pour soi» sont multipliés par l’attitude bornéé, voire hostile, à l’égard du Conseil communal, dont témoignent préavis retirés (voir sur ce site le dossier sur la «sécurité», pt. 3) et réponses tardives ou inexistantes aux interpellations. Cette attitude est le fait de l’ensemble de la Municipalité. Un exemple: en 2003, la Commission de gestion s’était proposée d’étudier ce qui se passait lors de la transition d’une Municipalité à une autre et la Municipalité avait alors hautainement refusé. Devant le Conseil communal, ce refus avait été activement soutenu par le Municipal socialiste P.-A. Dupont, y compris en interprétant tendancieusement un avis de droit du Service de Justice du canton (voir lettres, PV du CC du 13.113.2003 et avis de droit).
Il n’est donc guère étonnant que le 24 juin 2004, la Municipalité refuse de répondre aux questions posées lors du débat sur la gestion par A. Gonthier (voir PV de ce débat). Ni qu’à l’interpellation déposée lors de cette même séance par J.-P. Boillat («relancée» le 24 septembre), elle réponde avec arrogance – et illégalement [3] – le 4 novembre (!), sous la signature du vice-président P. Ducraux et du secrétaire P.-A. Perrenoud, qu’elle considère l’interpellation de J.-P. Boillat comme «nulle et non avenue» (voir le procès verbal de la séance du 4 novembre 2004). On peut certes soupçonner, en amont de la signature du vice-président de la Municipalité, la plume du syndic – le style, c’est l’homme –, mais il n’empêche que la décision est assumée par la Municipalité in corpore, sans qu’une voix divergente se soit fait entendre.
La Municipalité continue à refuser de se poser la moindre question, que ce soit sur le fond de l’affaire ou sur sa gestion par l’avocat-syndic. Lors de la séance du 2 décembre 2004 (voir PV), une déclaration-communiqué de presse au nom de la Municipalité unanime défend sans nuance son attitude et celle de son syndic. Le 16 juin 2005, une communication municipale (n° 13.2005, pdf) reprend pour l’essentiel les mêmes arguments. Le 30 juin 2005. lors du débat sur cette réponse, couplé à celui sur la demande d’un crédit complémentaire pour payer la somme facturée par le Tribunal cantonal, le «front municipal» est toujours ferme, encore qu’une première fissure apparaisse au sujet de la transmission d’une offre transactionnelle (Intervention M. Burnier).
Ce n’est qu’à la séance du premier septembre 2005, que quatre membres de la Municipalité «lâchent» le syndic (voir PV de la séance), déclarant que «plusieurs documents importants n’avaient pas été portés à la connaissance de la Municipalité, en particulier deux lettres de l’avocat de la partie adverse concernant une offre transactionnelle. Même si la formulation de ces documents peut donner lieu à discussion, il paraît inacceptable que ces offres n’aient pas été soumises à la Municipalité, seule autorité habilitée à trancher en l’espèce. En outre, il est apparu que la décision de la Municipalité prise le 10 avril 2003 de proposer une offre transactionnelle à la partie adverse n’a pas donné lieu à un courrier formel à ladite partie adverse. Dans ces conditions, la Municipalité de Vevey ne peut que présenter ses excuses au Conseil communal pour les affirmations erronées qu’elle a défendues devant lui, sur la base d’un dossier qui lui avait été transmis incomplet. Elle entend dès lors, par ailleurs, entreprendre la démarche suivante: confier à un expert du monde judiciaire un mandat visant à analyser la manière dont cette procédure a été menée.» Cet expert, l’ancien juge cantonal Reymond, a rendu son rapport (ou en pdf) le 2 décembre 2005.
La lucidité tardive vaut mieux qu’une cécité entretenue. Mais il est probable que si ces quatre membres de la municipalité avaient plus tôt écouté ce que leur disait le conseil communal, avaient imaginé que les questions et interpellations pouvaient avoir quelque intérêt et quelque raison, s’ils avaient repris en main le dossier au lieu de le laisser dans les seules mains du syndic, l’affaire n’aurait pas pris l’extension que l’on sait, et que la politique se serait épargnée quelque discrédit.
4. De l’affaire de mobbing à l’affaire Rigot: la dénégation obstinée de toute faute débouche finalement sur une rupture de confiance.
Si l’on suit le rapport Reymond, l’avocat Rigot n’a pas grand chose à se reprocher sur le plan professionnel, essentiellement parce qu’un autre avocat, ne faisant aucune erreur, n’aurait probablement pas abouti à une résultat différent (par exemple: déposer un mémoire n’aurait rien changé au jugement cantonal; l’offre de transaction faite par la commune, mais non-transmise par Me Rigot, était de toute façon trop basse pour être prise en considération; …). La phrase du rapport Reymond déjà citée (p. 34, question 8) «[…] si la Commune a perdu le procès, c’est parce que la cause était mauvaise et que l’appréciation de l’ancienne Municipalité, d’après laquelle la situation conflictuelle […] en 1995/1996 était principalement imputable à Mme X., s’est révélée fausse» résume bien son opinion. Une question se pose cependant: on est certes touojours plus intelligent après, mais comment expliquer que personne, de 1996 à 2003, ne se soit aperçu que la cause était mauvaise? comment se fait-il que la Municipalité et son avocat – en charge du dossier depuis 1997, rappelons-le – étaient encore persuadés de l'emporter jusques et y compris devant le Tribunal Fédéral ? Incompétence ? obstination ?
Au sujet du recours au Tribunal Fédéral, dernier acte de la procédure, initié par Me Rigot, le juge Reymond écrit (p. 12, C. ProcÚdures de recours): «Même si, dans ses considérants, [le TF] reproche souvent à la Commune de discuter les constatations de fait ou l'appréciation des preuves, ce que le recours en réforme ne permet pas, le Tribunal fédéral ne dit nulle part dans son arrêt de 19 pages que le recours était téméraire ou manifestement mal fondé. Au contraire, en page 18, il relève que l'indemnité pour tort moral fixée à 25'000 fr. par la cour cantonale "se situe assurément à la limite supérieure, sans que l'on puisse toutefois reprocher aux juges cantonaux d'avoir mésusé du pouvoir d'appréciation dont ils disposent en la matière"». Plus loin, le juge Reymond conclut (p. 33, question 9) «A mon avis, il était sage de recourir au Tribunal fédéral, sinon le Canton aurait sans doute reproché dans l’action récursoire à la Commune de n’avoir pas tout entrepris pour obtenir une décision favorable».
Pourtant, à lire ce jugement du TF, on ne peut s’empêcher de penser que le recours, écrit par D. Rigot pour le compte de Me Vogel (auquel, se défaisant enfin de sa double casquette, il avait remis la suite de l'affaire) n’était guère solidement fondé: le point mentionné par Me Reymond (montant de l'indemnité pour tort moral, point 8) est le seul sur lequel le TF accepte de discuter de l'argument de la commune: sur les points 2 à 7, il conclut brutalement que l'argumentation de la commune est simplement irrecevable. La décision finale est sans nuance: 1. Le recours est rejeté; 2. Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse [la commune]; 3. La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. Me Reymond semble ici bien indulgent.
Me Rigot, communiqué avant terme par son parti (voir le communiqué du Parti radical et les conditions de sa publication), se considère comme blanchi. Il oublie plusieurs appréciations sévères de Me Reymond: celui-ci donne tort à Me Rigot de ne pas avoir mis en cause plus tôt le canton (p. 26-27, question 1, point d, c’est «une erreur d’appréciation qu’un avocat particulièrement prudent n’aurait probablement pas commise»), contrairement aux affirmations assénées avec suffisance en justification de sa non-réponse à l’interpellation Boillat (Conseil communal du 4.11.2004). Il lui reproche une «inattention crasse» quant à la signature du bon de paiement à soi-même le 8 octobre 2002 (p. 29, question 5, point b) et un «manque de rigueur» concernant la lettre de Me Subilia d’avril 2003 (p. 32, question 7 point c). Il relève (p. 35, questions 3 et 4) que Me Rigot a violé les articles 74 et 75 de la Loi sur les communes et les articles 7, 17 et 18 du Règlement de la Municipalité. Et ceci dans l’exercice de sa fonction politique et de sa profession. [4]
Plus grave, le rapport Reymond relève que Me Rigot a expliqué de deux façons contradictoires pourquoi il n’a pas déposé de mémoire devant le Tribunal (pp. 7-8, B. Procédure…, point 3) alors «que la raison invoquée après coup pour expliquer ce revirement n’est pas convaincante» (p. 27, question 1, point e); et qu’il n’a pas transmis une offre de transaction à 150'000.– de la commune à Me Subilia. contrairement à ce qu’il a prétendu (p. 32, question 7, point c). Bref, qu'il a menti. [5]
Donnant la touche finale à ce qu'on a pu constater tout au long de cette affaire de mobbing, le rapport Reymond, malgré toute sa modération et sa diplomatie, trace ainsi un portrait peu favorable, non tant de l’avocat Rigot, que de l’homme politique – et du candidat: manipulateur; profitant du climat de confiance au sein du collège municipal pour mener sa barque à sa guise et faire défendre sa cause par ses collègues; toujours prêt à abreuver, avec superbe, le Conseil communal de demi- et de contre-vérités; refusant de jamais reconnaître la moindre faute, même vénielle. Bref pas vraiment quelqu’un de confiance. Reste aux électeurs à ne pas se laisser tromper une deuxième fois par les flots de papier glacé. Sans oublier que si Dominique Rigot est un problème, il n'est pas tout le problème…
1. Les renvois aux pages du Rapport Reymond se réfèrent à la mise en page d’origine, disponible en pdf sur ce site, mais aussi sur celui de la commune de Vevey. Les liens vers un document ouvrent ce document dans une nouvelle fenêtre; aussi vaut-il mieux le refermer après en avoir pris connaissance, sous peine d'être submergé en fin de lecture.
2. Le rapport Reymond contredit sur ce point la communication municipale 13/2005 en réponse à l’interpellation de M. Daniel Beaux, du 16 juin 2005 (question 5, page 3), où il est dit que la Municipalité s’est prononcée sur cette offre et l’a refusée.
3. L’article 34 de la Loi sur les communes, comme l’article 94 du règlement du Conseil communal de Vevey, prévoit que «chaque membre du conseil général ou communal peut, par voie d'interpellation, demander à la municipalité une explication sur un fait de son administration.» L’interprétation que fait la Municipalité de ce terme est fausse et réduit illégalement les droits du Conseil communal. «Un fait de son administration» doit être interprété comme «un fait de sa compétence». D’ailleurs si la loi avait voulu être restrictive, exclure qu’on puisse interpeller la Municipalité sur des faits de sa seule compétence, elle l’aurait expressément formulé, et aurait par exemple dit: «Chaque membre du conseil général ou communal peut … demander à la Municipalité une explication sur l’exécution par celle-ci d’une décision du Conseil communal», ou quelque chose d’équivalent. Elle ne l'a pas fait. En tout état de cause, déclarer «nulle et non avenue» une interpellation n'est prévu nulle part.
4. Il ne s'agit donc pas d'une infraction comme, par exemple, un excés de vitesse, dont le rapport avec la fonction ou la profession pourrait être considéré comme plus ou moins lointain.
5. Le rapport Reymond écrit au sujet des deux explications pour le non-dépôt du mémoire: «Peu importe, le fait est que Me Rigot n'a pas déposé de mémoire». Peu importe peut-être du point de vue du résultat, mais pas du point de vue de la morale politique.